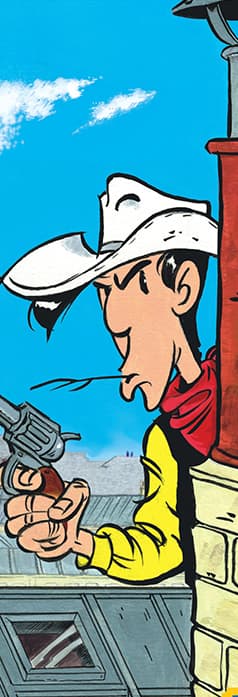Là où vont nos pères
Shaun Tan, l’auteur australien d’un des albums les plus étonnants et audacieux de l’année, donne quelques explications sur ce travail passionnant et impressionnant.
Mes travaux précédents m’ont fait réaliser que j’avais un intérêt récurrent pour la notion d’“appartenance“, qu’il s’agisse de la trouver ou de la perdre. Si cela a un rapport avec ma vie, ce qui n’est même pas certain, cet intérêt est plus inconscient que conscient. Une expérience significative pourrait bien être d’avoir grandi à Perth, une des villes les plus isolées du monde, perdue entre un vaste désert et un océan encore plus grand. De plus, mes parents se sont installés dans une banlieue récemment construite, sans identité ni histoire culturelle claire, donc. Être à moitié Chinois, à un moment et un endroit où cela était complètement inhabituel a aussi pu accentuer cet intérêt, puisqu’on me demandait systématiquement “d’où je venais ?“, ce à quoi ma réponse “d’ici“ ne provoquait qu’une question supplémentaire “d’où viennent tes parents ?“ Au moins ceci était-il une attention beaucoup plus positive que le racisme occasionnel et de basse intensité que j’avais pu expérimenter pendant mon enfance, ou, plus ouvertement ou sournoisement, remarquer à l’encontre de mon père, de temps à autre. En grandissant, j’ai donc eu une vague sensation de “séparation“, une notion pas très claire d’identité ou de déracinement.
Pourtant, au-delà de toute problématique personnelle, je crois que le “problème“ de l’appartenance est peut-être plus une question existentielle basique, que tout le monde affronte de temps en temps, ou régulièrement. Et que ce problème remonte à la surface quand quelque chose ne va pas dans nos vies, ou remet en cause notre confortable réalité ou nos attentes — ce qui est typiquement le moment où commencent les bonnes histoires. On a tous connu des expériences nouvelles : une nouvelle école, travail, relations ou pays, chacune exigeant de se réinventer une “appartenance“.
J’avais tout ceci à l’esprit pendant la longue période de travail sur Là où vont nos pères, qui traite de cette expérience. L’histoire de quelqu’un qui quitte son foyer pour trouver une nouvelle vie dans un pays inconnu, où même les plus simples détails de la vie quotidienne sont étranges, conflictuels ou déconcertants — sans parler du langage. C’est une idée à laquelle j’ai pensé pendant un certain nombre d’années avant qu’il ne se cristallise en scénario pour un livre.
Le livre n’a pas une source unique, mais vient plutôt de la convergence de plusieurs idées. J’ai pensé d’abord à l’histoire, d’une certaine manière invisible, de la communauté chinoise d’Australie Occidentale.
Plus directement, mon père est venu de Malaisie en 1960, pour étudier l’architecture en Australie, où il a rencontré ma mère. Les histoires de mon père sont sommaires, et se concentrent en général sur des détails précis — la nourriture désagréable, le climat trop chaud ou trop froid, les malentendus amusants, la solitude, etc. Les différentes témoignages de migrants que j’ai pu recueillir (de l’Australie d’après-guerre jusqu'à l’immigration de masse aux USA autour de 1900), m’ont montré que c’étaient les détails au jour le jour qui en disaient le plus sur cette expérience humaine universelle commune. Cela m’a rappelé que l’émigration a une part fondamentale dans l’histoire de l’humanité, dans un passé récent comme lointain. Et je me suis rendu compte de tous les problèmes rencontrés par les migrants, quelle que soit leur origine ou leur destination : les difficultés liées à la langue, le mal du pays, la pauvreté, la perte de statut social et des qualifications, sans parler de la séparation d’avec la famille.
Il m’a alors semblé que pour raconter tout cela, une longue histoire visuelle, sans aucun mot, pourrait au mieux capturer ces sensations d’incertitude et de découverte que j’avais absorbées dans mes recherches. J’ai aussi été frappé par l’idée d’emprunter le “langage” des vieilles archives photographiques et des albums de famille que j’avais regardés, tous ayant une grande clarté documentaire et ce ton en sépia silencieux et énigmatique. J’ai réalisé que les albums photos ne sont rien qu’une autre sorte de livre illustré que tout le monde fabrique et lit, une suite d’images chronologiques illustrant l’histoire de quelqu’un. Ils fonctionnent en faisant appel à la mémoire et l’amener à remplir les vides par notre propre histoire.
Dans Là où vont nos pères, l’absence de description écrite plante le lecteur plus fermement dans les chaussures d’un personnage d’immigré. Il n’est pas guidé dans la manière dont il doit interpréter les images. Les mots ont une remarquable force magnétique sur notre attention et comment nous interprétons les images afférentes : sans eux, une image peut avoir un plus grand espace conceptuel autour d’elle, et obliger le lecteur à plus d’attention, qui autrement, pourrait aller à la signification valable la plus proche, et laisser ainsi son imagination être dirigée.
Bien sûr, cela me créa des contraintes, les mots étant des convoyeurs d’idées formidablement pratiques. En leur absence, décrire même la plus simple des actions, comme quelqu’un faisant sa valise, achetant un billet, cuisinant ou demandant du travail, menaçait de devenir extrêmement compliqué, laborieux et périlleux à l’étape du dessin. J’avais à trouver une manière de mener cette narration qui fût praticable, claire et légère visuellement.
Involontairement, je me suis retrouvé à travailler sur un « graphic novel » plutôt que sur un livre illustré. Il n’y a pas de grande différence entre les deux, mais un roman graphique insiste peut-être plus sur la continuité entre les multiples images, et est plus proche en fait, de bien des façons, de la réalisation d’un film que de l’illustration. Je n’ai jamais été un grand lecteur de bande dessinée (étant venu à l’illustration par la peinture), donc une grande partie de mon projet a été redirigée par l’étude de différentes bande dessinée. Quelles formes ont les cases ? Combien doit-il y en avoir sur une page ? Quand et comment passer d’un instant à un autre ? Comment contrôler le rythme de l’histoire, spécialement quand il n’y a pas de mots ? Une référence utile fut Understanding Comics de Scott McCloud, qui détaile de nombreux aspects de “l’art séquentiel” de manière à la fois théorique et pratique, très utile notamment parce qu’il s’agit d’un essai écrit en bande dessinée très intelligemment. J’ai également remarqué que beaucoup de mangas utilisaient largement la narration silencieuse, et exploitaient un sens du rythme visuel très différent de l’occidental, ce que j’ai trouvé très instructif. Simultanément, j’avais récemment travaillé en tant que réalisateur sur une adaptation en animation de The Lost Thing (où l’essentiel de la narration est silencieuse) et donc étudié de près les techniques de story-board utilisées dans cette industrie. Toutes ces “éudes” ont nourri le style et la structure du livre tout au long des plusieurs versions complètes réalisées.
Concrètement, le processus de création des images finales ressembla plus à l’écriture d’un film qu’à de l’illustration conventionnelle. Réalisant l’importance que les images multiples soient cohérentes entre elles, couplée à un intérêt stylistique des photos anciennes, j’ai physiquement construit quelques “objets” de base avec des bouts de bois ou des morceaux de réfrigérateurs, meubles et autres fournitures de maison. Ces “maquettes” sont devenus de simples modèles pour les structures dessinées dans l’album, des bâtiments aux tables pour le déjeuner. Avec le bon éclairage, et des amis gentiment jouant les rôles des personnages d’abord rapidement essquissés, je fus capable de filmer ou photographier des compositions et séquences d’actions qui semblaient s’approcher de chaque scène. J’ai alors joué sur ordinateur avec ces images fixes, tout en les sélectionnant, les distordant, ajoutant ou soustrayant, dessinant par dessus, essayant plusieurs agencements pour voir comment elles pouvaient être « lues ». ceci devint les références de composition pour les dessins finaux, qui furent alors exécutés avec une méthode bien plus traditionnelles — mine de plomb sur papier. Le processus complet demanda environ une semaine par page de deux à douze images… sans compter les essais non-retenus, qui furent nombreux.
L’essentiel des difficultés consista à combiner des références visuelles réelles pour les gens et les objets dans un univers entièrement imaginaire, comme cela avait toujours été le concept central, dès le départ. Pour mieux faire comprendre ce que doit être le fait de voyager vers un pays nouveau, j’ai voulu créer un endroit fictif, qui serait étranger à tous les lecteurs, quel qu’en soit l’âge ou l’histoire personnelle (moi compris). C’est bien entendu ici que mon penchant pour les “endroits étranges ” prit son envol, puisque j’avais déjà des idées pour un endroit où les oiseaux seraient “plus ou moins” des oiseaux, et les arbres “plus ou moins” des arbres. Où les gens s’habilleraient bizarrement, les équipements ménagers susciteraient la confusion et où les activités dans les rues sembleraient très étranges. J’imaginais que ce serait le cas aussi pour la plupart des immigrants, une situation qui peut être examinée de manière idéale par l’illustration, le moindre détail pouvant être dessiné.
Ceci étant dit, les mondes imaginaires ne devraient jamais être de pure imagination, et sans la moindre part de vérité, ils peuvent aisément bloquer l’incrédulité provisoire du lecteur, ou simplement trop l’embrouiller. Trouver le juste équilibre entre les objets du quotidien, les animaux et les gens, et leur alternatives fantaisistes m’a toujours intéressé. Pour Là où vont nos pères, je n’ai cessé de dessiner mes souvenirs personnels de voyages en pays étrangers, ce sentiment d’avoir des notions basiques mais imprécises de ce qui m’entourait, cette conscience de mon environnement pourtant saturée de sens cachés : toujours très étrange, mais toujours grandement convainquant. Dans mon propre pays sans nom, des créatures étranges émergent de pots et de bols, des lumières flottantes dérivent de manière inquisitrice dans les rues, les portes et placards dissimulent leurs contenus, et partout il y a ces notes qui signalent, invitent ou avertissent par de lourds e indéchiffrables alphabets. Tout ceci sont autant d’équivalents d’expériences vécues en tant que voyageur, quand la compréhension des faits les plus simples est un défi.
Une de mes principales sources de référence visuelle a été le New York du début des années 1900, un grand port d’immigration de masse pour les Européens. Beaucoup des « images utiles » collées aux murs de mon atelier étaient de vieilles photographies des processions d’immigrants à Ellis Island, des notes visuelles qui procurèrent des idées, ambiances et atmosphères sous-jacentes à de nombreuses scènes du livre. D’autres images que j’avais rassemblées dépeignaient de scènes de rue de villes européennes, asiatiques, et moyen-orientales, des véhicules anciens, des plantes et animaux divers, enseignes de magasins et affiches, intérieurs d’appartements, photos de gens travaillant, mangeant, discutant et jouant, tous choisis autant pour leur aspects ordinaires que potentiellement étranges. Les élements dans les dessins ont ainsi évolué raduellement à partir de ces origines plutôt simples. Une sculpture colossale au milieu d’un port, la première étrange vue qui s’offrait aux migrants arrivant, suggère quelque sœur de la Statue de la Liberté. Une scène d’immigrants voyageant dans un nuage de ballons blancs fut inspirée par des images de migrants embarquant dans des trains autant que par la dispersion de polypes coraliens vus de nuit, deux idées associées à des thèmes communs sous-jacents — dispersion et régénération.
Même les phénomènes les plus imaginaires du livre ont été pensés pour apporter un certain poids métaphorique, même s’ils ne se réfèrent à rien de spécifique, et sont diffiiciles à expliquer complètement. Une des images à laquelle j’ai pensé pendant des années impliquait une scène d’immeubles d’habitations délabrés, par dessus qui “nageaient” des espèces d ‘énormes serpents noirs. J’ai réalisé que cela pouvait être lu de nombreuses manières : comme une infestation de monstres, ou plus figurativement, comme une sorte de menace oppressante. Même alors, il est laissé à l’appréciation du lecteur de décider si cela est politique, économique, personnel ou autre chose, dépendant de quelles idées ou sensations l’image a pu inspirer.
Je suis rarement intéressé par la symbolique, quand une chose “veut dire” quelque chose d’autre, parce que cela dissout le pouvoir qu’a la fiction à être réinterprétée. Je suis plus attiré par une sorte de résonnance intuitve ou poétique que l’on peut sentir en regardant des images, et “comprendre” ce que l’on voit sans nécessairement être capable de l’énoncer. Un des personnage clé de mon histoire est une créature qui ressemble à quelque chose comme un tétard marchant, gros comme un chat et qui doit former une amitié inattendue avec le personnage principal. J’ai mon sentiment quant à la signification de tout cela, encore une fois quelque chose lié à l’apprentissage d’une appartenance et de l’acceptation, mais j’aurais de gros problèmes à essayer d’exprimer ça avec des mots. Il me semble que cela a beaucoup plus de sens en tant qu’une série de dessins au crayons silencieux.
Je cherche souvent, dans chaque image, des choses suffisamment étranges pour inviter à la plus grande interprétation personnelle, tout en maintenant un certain réalisme. L’expérience de beaucoup de migrants, en fait, trace un parallèle intéressant avec la voie critique et créative que je tente de suivre artistiquement. Il y a une manière similaire de chercher des significations, sentiment et une identité dans un environnement qui peut être alternativement transparent et opaque, sensé et confus, mais toujours ouvert à la ré-évaluation. J’espère que derrière son sujet immédiat, toute narration graphique puisse encourager le lecteur à prendre un moment de recul par rapport à sa “réalité ordinaire”, et à la placer dans une perspective bien différente. Un des grands pouvoirs des arts narratifs est de nous inviter à nous mettre à la place de quelqu’un d’autre pendant un moment, mais, peut-être encore plus important, de nous inviter à réfléchir à notre propre place. On ferait bien de penser à nous –mêmes comme de possibles étrangers dans notre monde étrange à nous. Les conclusions à tirer de tout cela sont difficiles à résumer simplement, une raison de plus pour réfléchir aux connections entre les gens et les lieux, et à ce que nous voulons dire quand nous parlons “d’appartenance”.